Pascal Manoukian : Le Cercle des Hommes
Pascal Manoukian est un ancien reporter de guerre. Durant plus de 20 ans, il a parcouru l’Irak, le Liban, la Yougoslavie et couvert l’ensemble des grands conflits du XXe siècle. Devenu directeur de l’agence de presse CAPA, il a déjà écrit une demi douzaine de romans et sort ce mois-ci Le Cercle des Hommes. Dans ce nouvel ouvrage, il met en scène la rencontre d’un grand PDG occidental avec l’une des tribus indiennes les plus reculées d’Amazonie. Entre choc des cultures et remise en question, cette plongée dans la canopée sauvage est une très belle réflexion sur la quête du bonheur et les dérives de notre société contemporaine. Rencontre.

Florence Yérémian : Comment est née la trame de votre nouveau roman « Le Cercle des Hommes » ? Est-ce une fiction complète ou vous êtes-vous inspiré d’un voyage personnel en Amazonie ?
Pascal Manoukian : Ce roman est né d’une très lointaine expérience. Il y a plus de 40 ans, quand le monde était encore déconnecté d’internet, des GPS et des portables, j’ai eu la chance, avec deux compagnons d’aventure, de participer à une expédition en Amazonie colombienne. Après six mois de survie totale en forêt, nous avons effectué un premier contact avec une tribu isolée. J’ai vécu plusieurs semaines comme aux origines, avec un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, des hommes et des femmes vivant en harmonie parfaite avec les animaux et les plantes, comme il y a dix mille ans, sans presque laisser d’empreinte écologique. Cette expérience a changé ma vie. Quarante-cinq ans plus tard, j’ai eu le bonheur d’avoir une petite fille, Jade. En voyant le monde que ma génération s’apprêtait à lui laisser, j’ai repensé à mes indiens et à leur respectueuse façon de vivre. Alors l’idée de ce choc entre nos deux mondes m’est venue.
Qu’en est-il de la tribu des Yacou : existe-t-elle vraiment ou est-ce une invention ? Vous décrivez le quotidien de ces indiens d’Amazonie avec une telle minutie, comment avez-vous connu toutes ces coutumes, ces légendes, ce vocabulaire ?
Les Yacou en tant que tels n’existent pas. Je leur ai donné vie pour cette histoire. Je me suis amusé à leur créer un univers, des traditions, une langue, un mythe, en m’inspirant de mon expérience amazonienne et des nombreux récits lus au cours de la préparation de notre expédition. Je n’ai gardé de ma rencontre avec ma tribu, il y a plus de quarante ans, que les prénoms et quelques mots de vocabulaire. Comme dans mes autres livres, tout est inventé, mais tout pourrait être vrai. Je veux dire par là que rien n’est exagéré, tout est crédible.

Quel est votre regard personnel sur les indiens d’Amazonie et les peuples indigènes qui résistent à la modernisation de notre XXIe siècle ? Est-ce une incohérence ? Un bienfait ?
Ce sont des fossiles vivants. Un miroir de ce que nous étions avant de nous sédentariser. Nous sommes l’incohérence. La sédentarisation ne nous a apporté que des contraintes. Bien sûr, longtemps nous n’en avons perçu que les avantages et ils ont été nombreux, si nous nous comparons aux tribus isolées: Richesse, santé, espérance de vie… Mais à quel prix ? Nous avons vécu à crédit jusque-là, sans nous soucier du véritable coût de cette décision. Nous avons hypothéqué la seule planète capable de nous accueillir et aujourd’hui on nous présente une addition, qui semble bien trop lourde pour que nous puissions nous en acquitter. Il existe à l’heure actuelle, encore une soixantaine de tribus isolées comme les Yacou au Brésil. Quelques milliers d’individus tout au plus. Aujourd’hui ce sont eux qui survivent. Dans le monde de demain ce sera peut-être nous.
Selon vous, ces tribus détiennent-elles le secret du bonheur en demeurant coupées du monde et en faisant corps avec la nature ? Prônez-vous cet état de nature ? Ce retour à l’essentiel ? A l’exemple de votre jeune aventurier, rêvez-vous personnellement de « pureté et de solitude, loin du monde perverti ? »
Mais nous avons tous encore en nous quelque chose des Yacou que nous étions. C’est inscrit profondément dans nos gènes. Inconsciemment c’est ce que nous cherchons tous à retrouver quand nous allons faire une balade en forêt, nous perdre parmi les arbres, quand nous nous asseyons sur le parquet d’un salon devant un feu de cheminée, quand nous racontons dans la pénombre d’une chambre des histoires à nos enfants. Il n’y a que très peu de temps que nous nous sommes coupés du reste de la biodiversité. Ça date de la révolution industrielle. Notre cerveau s’est construit à 99% lorsque nous étions encore au contact de la nature. L’amputation d’avec notre milieu naturel a été brutale pour nos corps et notre esprit. Nous en avons tous encore secrètement la nostalgie. C’est pour cela qu’enserrer un arbre fait baisser la tension. Que les maladies mentales sont plus fréquentes en milieu urbain. Qu’on rumine moins ses pensées négatives dans la nature. Que le chant des oiseaux permet de récupérer plus rapidement du stress. Nous sommes encore très liés à ces tribus.
Ces tribus détiennent-elles le secret du bonheur ? Du leur sans aucun doute. Je les ai vues heureuses, comme rarement j’ai vu des gens heureux, assis simplement en cercle, chacun prenant soin de l’autre. Détiennent-elles le secret de notre bonheur ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Nous nous sommes trop éloignés des choses essentielles pour pouvoir les retrouver. Nous n’avons plus la connaissance. Pour apprendre tout ce nous nous avons cru important, nous avons dû oublier des savoirs plus importants encore. Mes indiens n’étaient pas impressionnés quand je leur ai dit que nous avions marché sur la lune. Eux y allaient souvent, mais sans lanceur, ni fusée, sans bouger du cercle et toujours sans laisser d’empreinte écologique. Nous devrions écouter un peu ce que ces peuples qui ont survécu à tout, ont à nous dire. Il ne s’agit pas de revenir à l’âge des cavernes, mais de comprendre, pendant qu’il est encore temps qu’il existe d’autres voies possible que de considérer la terre comme un système de ressources infinies.

Votre ouvrage nous fait parfois songer à un manifeste contre les dérives de notre monde contemporain : que reprochez-vous en priorité à notre société ? Son attachement au matériel ? Sa démesure ? Sa destruction de la biodiversité ?
Son aveuglement. Aujourd’hui tout le monde ou presque est d’accord. Nous sommes en train d’épuiser la seule planète sur laquelle notre forme de vie est possible. Pour ne donner qu’un exemple, la plupart des grands fleuves du monde sont sous antibiotiques, à cause de l’élevage et de l’épuration des eaux usées, c’est à dire que l’on y trouve plus de 300 fois les taux autorisés. Et pourtant on s’inquiète moins du monde que nous allons laisser à nos enfants que de leur future régime de retraite. Mais à quoi sert l’un sans l’autre. Malgré les avertissements des scientifiques, nous continuons à croire que nous avons encore le temps de tergiverser, que notre modèle économique n’est pas à revoir entièrement, qu’il n’est pas nécessaire de revenir à un comportement moins destructeur, plus partageur. C’est un thème transversal à tous mes livres. Il est temps de concevoir un autre moteur que le profit et la réussite individuelle. Pourquoi cet aveuglement ?
Il faut arrêter de considérer la nature comme si nous n’en faisions pas intégralement partie. Ce n’est pas un élément de décor. La planète se fout de l’homme. Elle existe depuis 5 milliards d’années, elle se passera de lui.
A votre avis, comment pouvons-nous encore maintenir l’équilibre des espèces, des ressources et des éléments ?
Je n’ai malheureusement pas la solution. Il faudrait déjà réussir à arrêter la mécanique avant de chercher à l’inverser, en proposant des solutions simples et faciles à appliquer, des solutions positives pour tout le monde surtout. Imposer à toute la restauration collective de s’approvisionner en circuit court, par exemple, ça changerait à la fois l’agriculture et la vie de nos enfants. L’agriculture intensive n’est pas la solution, ni pour l’environnement, ni pour la santé du consommateur, ni même pour le revenu de l’agriculteur. On sait maintenant de quelle façon obtenir des rendements équivalents en mélangeant les espèces végétales, en réinstallant les haies qui sont des abris pour les prédateurs des nuisibles des champs, en réduisant le gaspillage des denrées alimentaires. Mais il faudrait bien sûr, pour être efficace, imposer, chaque solution dans chaque pays. C’est toute la difficulté, parce qu‘il est difficile de faire ouvrir les yeux à 7 milliards d’individus en même temps. Chacun préfère s’en remettre lâchement à l’autre pour amorcer le changement, en espérant secrètement s’en sortir sans effort. Je crois beaucoup aux utopies réalistes aussi, elles ont toujours fait bouger le monde (La fin de l’esclavage, l’Europe, l’invention de la sécurité sociale…) Alors on peut rêver. Pourquoi, par exemple, ne pas réconcilier écologie et économie. L’industrie moderne s’est fondée sur la destruction de la nature. Elle n’a considéré que le profit de quelques-uns. Si nous arrivons à lui faire comprendre que ces temps-là sont révolus, que demain, pour continuer à encaisser encore plus de dividendes, son intérêt est de protéger et non plus de détruire. Alors elle est capable, par simple intérêt, de retourner la situation. Et on connait sa force de frappe.

Votre écriture est souvent crue et cruelle, parfois elle est même excessive voire provocatrice : vous nous livrez des scènes de torture, de rites mortuaires, de rut, vous ramenez l’humain au stade animalier, comment expliquez-vous cette « brutalité textuelle », cet acharnement à décrire si bien la barbarie ?
Provocatrice et excessive je ne pense pas. Crue et cruelle souvent. J’essaye de raconter le monde partout où l’humanité recule. Celui des guerres dans ” La Diable au creux de la main”, celui des migrants dans “Les échoués“, celui de Daesh dans “Ce que tient ta main droite t’appartient”, celui du monde ouvrier dans “Le Paradoxe d’Anderson” et celui des derniers indiens dans “Le Cercle des Hommes” et ces mondes ont une chose en commun, il sont durs et cruels. On s’y bat pour survivre. C’est la réalité. Je le sais car je les ai tous fréquentés. Dans le “Cercle des Hommes”, c’est toute la question. Mon héros ( qui n’est en rien un aventurier mais au contraire, un acheteur vendeur, ne risquant que la vie des autres, un pur produit de la mondialisation) s’écrase avec toute la suffisance de sa réussite, en plein cœur d’une tribu isolée, des nomades, chasseurs-cueilleurs, pour qui chaque gramme transporté compte et qui vont donc devoir, décider, avant de s’en encombrer, si la chose très mal en point, aveugle, brûlée, difforme, amnésique est un homme ou un animal. Et malheureusement tout ce qui fait de mon industriel un homme n’a pas cours chez eux. Ils vont donc le traiter comme un trophée de chasse et c’est lui qui va devoir leur prouver qu’il mérite de s’asseoir parmi eux.
C’est le point de vue des Indiens qui est important dans ce livre. Leur “Cercle” est un havre de paix par rapport au monde qui l’entoure. La violence vient presque toujours de l’extérieur. Notre monde est mille fois plus cruel. Il suffit d’allumer un quart d’heure la télé pour s’en rendre compte.
Pensez-vous que votre écriture soit cathartique ? On ressent, en effet, cette même férocité descriptive dans vos romans précédents. Est-ce une façon – consciente ou inconsciente – de faire sortir toutes les médiocrités et les horreurs humaines que vous avez confrontées durant vos reportages de guerre ?
Je ne pense pas. J’ai réglé mes problèmes au fur et à mesure avec ça, en prenant soin, à chaque retour, non pas d’aller voir un psy, mais de laisser au Manoukian de tous les jours, le temps de questionner sans tabou le Manoukian journaliste. Une sorte d’autocritique continue. Simplement, après l’avoir fait pour la presse, je continue de raconter le monde en littérature cette fois et je retourne à mes années de terrain pour en extraire la matière première.
Vous nommez votre héros « l’Homme-Cochon », en faisant sans cesse référence à sa « nature porcine ». Est-ce justement une façon de dénoncer l’homme dans ce qu’il a de plus vil ? De montrer aux lecteurs qu’à cause de ses vices, son besoin de pouvoir, sa violence, son orgueil, l’humain finit par tomber plus bas que l’animal en dépit de son éducation et de son instruction ?
Je leur prête ma plume mais ce sont les Yacou qui considèrent au début de l’histoire, après l’avoir longuement observé, à cause notamment de ses poils, de son incapacité à émettre le moindre son, de son odeur de grillé et de sa puanteur, que notre industriel tient plus du cochon que de l’homme, même si son sexe rappelle un peu le leur. Mais oui bien sûr je m’en amuse. Lui, le puissant, le roi des fusions acquisitions, des plans sociaux, lui qui règne sur des centaines de milliers de salariés sans en connaître aucun et qui s’est plus souvent conduit en prédateur qu’en homme, se voit tout naturellement reconnaitre cette qualité par indiens, très habitués à faire la différence.
Savez-vous déjà sur quoi portera votre prochain roman ?
Ce sera sans doute un roman sur le pouvoir grandissant de l’argent, sur le combat entre l’intérêt de tous et l’intérêt de quelques-uns, sur les menaces faites à la liberté d’informer.



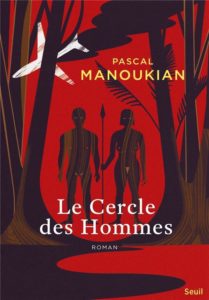 Le Cercle des Hommes
Le Cercle des Hommes



